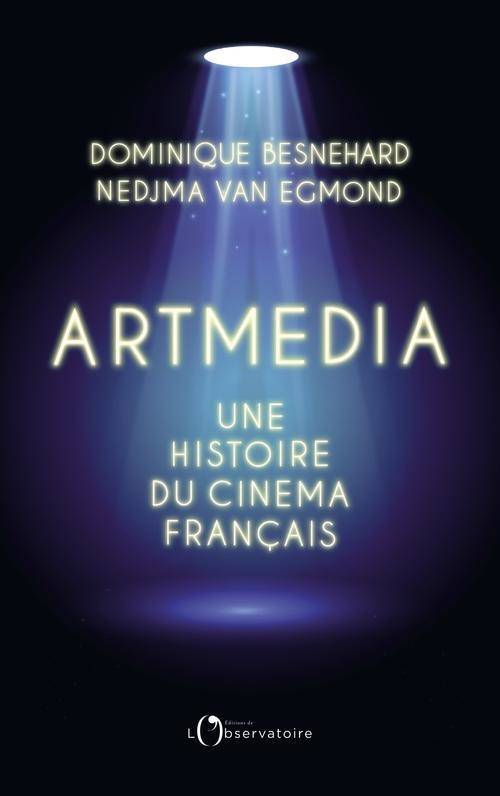
Comment est née l’idée de ce livre ?
Muriel Beyer, qui avait publié Casino d’hiver que j’avais coécrit avec Jean-Pierre Lavoignat, avait envie d’un livre sur la série Dix pour cent. Or il en existait déjà un... Mais sa proposition m’a fait repenser au Nouvel Hollywood écrit par Peter Biskind. Et plutôt qu’un livre sur Dix pour cent, j’ai eu envie d’un ouvrage sur l’agence qui a inspiré la série : Artmedia où j’ai passé plus de vingt ans, de 1986 au milieu des années 2000.
Mais ce livre vous n’allez pas l’écrire seul. Pourquoi ce choix ?
Ce livre nécessitait de faire une vraie enquête, or je connaissais trop les protagonistes pour la réaliser moi-même. Je me suis d’abord tourné vers mon coauteur de Casino d’hiver, Jean-Pierre Lavoignat, mais il était pris par d’autres obligations. J’ai alors eu envie de travailler avec une autre journaliste que je connaissais et que je pensais parfaite pour ce type d’enquête : Nedjma Van Egmond qui, bien que passionnée de cinéma et de théâtre, n’avait ni passé ni passif avec celles et ceux qu’elle allait rencontrer. J’ai participé à la partie de l’enquête sur la création d’Artmedia et les années consacrées à son créateur Gérard Lebovici où je n’étais pas encore agent, car ça me passionnait. Mais pour la suite de l’aventure, Nedjma a interviewé les différents intervenants seule. Elle venait me raconter chaque soir le fruit de ces entretiens. Et je peux vous dire qu’elle m’a appris énormément de choses que je ne savais pas.
Votre livre raconte Artmedia à travers ses hauts et ses bas, sa toute-puissance jusqu’au milieu des années 2000, puis la manière dont la structure a peu à peu perdu de sa superbe pour être dépassée par la concurrence. Comment expliquez-vous ce déclin ?
Sans doute à cause d’un mauvais management de Bertrand de Labbey qui a dirigé l’agence de 1990 à 2016. J’ai énormément de respect pour lui. On est les exacts contraires et c’est précisément ce qui fonctionnait quand on travaillait ensemble. Je pense qu’après mon départ, il aurait dû procéder à un état des lieux pour organiser à terme sa succession et apaiser les clans qui existaient, comme dans toute structure. Dans une agence, il y a toujours besoin de sang neuf, d’intégrer des collaborateurs qui amènent un nouveau souffle et de les faire évoluer. C’est exactement ce qu’avait voulu faire Gérard Lebovici dans les années 70 quand il a voulu me rencontrer après que Serge Rousseau, grand agent d’Artmedia, lui a parlé de moi et de mon travail comme directeur de casting.
Cette première rencontre a été plutôt froide, comme vous le racontez dans le livre...
D’une froideur extrême même ! En fait, Gérard Lebovici était persuadé que j’allais intégrer Artmedia alors que je voulais encore m’amuser un peu comme directeur de casting. Et quand je le lui ai dit, il m’a balancé : « Il ne faut pas s’amuser trop longtemps, car il sera bientôt trop tard. » Alors même que, pendant une heure, il n’avait quasiment prononcé aucun mot ! Il était impressionnant. Finalement, je n’ai intégré Artmedia que des années plus tard, en 1986, quand Jean-Louis Livi dirigeait l’agence, donc je n’ai jamais travaillé avec Gérard Lebovici. Mais pour revenir à Bertrand de Labbey, si dans le livre on pointe ses erreurs de management, il ne faut pas oublier son apport décisif à Artmedia qu’il a su professionnaliser pour tendre vers le fonctionnement des agences américaines. Jean-Louis Livi dirigeait Artmedia en affectif. Bertrand a su la structurer. Mais il n’a pas voulu envisager sa propre succession : ça lui était insupportable.
Avec le recul, quel regard portez-vous sur vos années Artmedia ?
Je m’y suis follement amusé mais il était temps que je parte. Physiquement. Moi qui ne fume pas et ne bois pas, je compensais le stress par la nourriture. J’avais pris 20 kilos. Comme un réceptacle de toutes les angoisses que je recevais. Car je m’impliquais émotionnellement. Ma famille, c’était les acteurs. Je ne peux pas vivre sans la création, sans les gens qui me racontent leurs projets.
Vous aviez conscience de la toute-puissance d’Artmedia à cette époque ?
Évidemment, mais j’ai aussi le sentiment d’avoir un peu démocratisé son fonctionnement. Quand j’étais directeur de casting, il n’existait même pas de liste des acteurs représentés par l’agence. Ça paraît surréaliste aujourd’hui. J’ai aidé à assouplir tout ça, y compris dans le choix des comédiens que j’ai fait entrer à l’agence.
En poursuivant votre travail de directeur de casting, vous allez en effet y faire rentrer toute une génération d’inconnus que vous dénichez hors des murs des écoles de théâtre. Beaucoup vont cependant disparaître des radars très vite, après deux ou trois ans dans la lumière...
Je cherchais en effet des acteurs qui ne rêvaient pas forcément de ce métier et venaient de la rue. Et je reconnais avoir participé à ce système qui en a laissé beaucoup sur la route. Il y a eu une sorte d’hécatombe dans les années 80 même si elles ont aussi vu émerger Juliette Binoche, Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Béart, Béatrice Dalle et Sophie Marceau.
Et beaucoup ne seront la jeune femme ou le jeune homme que d’un ou deux rôles. Je me souviens de Simon de La Brosse. Après Travelling avant, Les Innocents ou La Petite Voleuse, il devait jouer dans une pièce mise en scène par Michel Piccoli qui était fou de son jeu. Mais il a commencé à plonger dans la drogue et il est passé à côté. La drogue a fait tomber toute une génération de gens très talentueux. S’en sont sortis ceux qui ont fait du théâtre ou qui avaient une rigueur et savaient où ils voulaient aller.
Qu’est-ce qui a le plus changé dans ce métier d’agent entre l’époque où vous le pratiquiez et aujourd’hui ?
Les agents ont aujourd’hui beaucoup plus de travail tout en touchant les mêmes 10 % qu’à mon époque. Ils doivent s’occuper des conseils artistiques, des contrats, du management... Alors qu’aux États-Unis, tout ceci est depuis longtemps divisé entre agents et publicistes. Un agent peut donc vraiment se concentrer sur l’artistique. En France, on leur demande trop de services. Avec la difficulté croissante à financer les films et le flou que cela engendre dans la carrière des comédiens, cet aspect multitâche à marche forcée est de plus en plus dur à gérer au quotidien. Cela explique pourquoi de plus en plus d’acteurs sont infidèles : ils pensent que leur agent ne s’occupe pas assez d’eux.
Dans toutes les vies que vous avez eues – directeur de casting, agent, producteur, directeur de festival – quelle place tient celle où vous étiez agent ?
C’est la vie que j’ai préférée. En tout cas au début. Car elle m’a permis d’avoir des relations suivies et pas simplement épisodiques comme lorsque l’on fait du casting. Et par ricochet de nouer des amitiés fortes avec des comédiens. Participer à la construction d’une carrière est passionnant. Même si cela veut aussi dire partager les angoisses de l’artiste, les absorber pour les soulager. Mais ce sont des moments inoubliables.
Et quand ce métier vous bouffe trop, il faut savoir partir comme je l’ai fait.
Être agent, c’est aussi annoncer ou cacher de mauvaises nouvelles...
Quand Chabrol avait refusé de prendre Jean-Claude Brialy pour La Cérémonie parce que « Jean-Claude était gratuit », il voulait dire par là qu’on le voyait partout – à la télé, comme animateur radio... – et que sa présence au cinéma n’était plus un événement en soi, qu’il ne savait plus se faire désirer. Pour Jean-Claude, qui s’intéressait beaucoup aux autres, ces nombreuses activités étaient une manière de ne pas être seul avec lui-même. Chabrol avait finalement choisi Jean-Pierre Cassel qui était l’ami mais aussi le rival de Jean-Claude. Cette vérité-là était impossible à dire. Chabrol m’avait d’ailleurs demandé de ne pas la répéter. En tant qu’agent, il faut donc inventer une explication. Et généralement, tu te fais engueuler car l’acteur en question trouve que tu ne l’as pas assez bien défendu. Le travail de l’agent est de prendre sur lui pour éviter ce type de drames collatéraux.
« Artmedia : Une histoire du cinéma français » de Dominique Besnehard et Nedjma Van Egmond. Éditions de l’Observatoire





