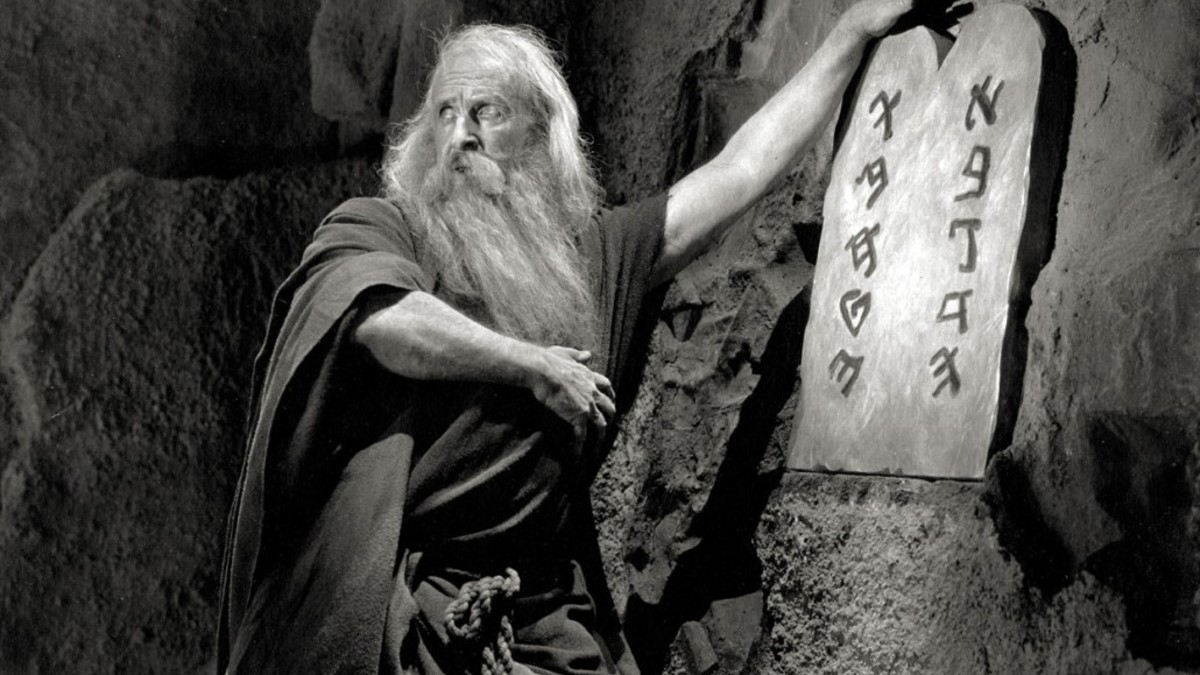Le plus romantique – 14 juillet (1933)
Nous sommes aux débuts du cinéma parlant. Le pionnier René Clair (Entr’acte, Un chapeau de paille d’Italie) signe son quatrième film sonore - les dialogues sont encore limités. Dans cette histoire d’amour naissante pleine de malentendus entre une fleuriste (Annabella) et un chauffeur de taxi (Georges Rigaud), le bal du 14 juillet sert de décor à un serment romantique entre les deux tourtereaux. Un Paris populaire, tout droit sorti de Victor Hugo, est filmé de manière burlesque, candide et tragique par la caméra virevoltante de Clair, le réalisateur le plus inventif de sa génération.
Le plus historique – La Révolution française : les années Lumière (1989)
Sorti pour le bicentenaire de la Révolution, ce film de commande en deux parties réalisé par Robert Enrico et Richard Heffron est le film le plus exhaustif sur la période et il a bénéficié d’un budget conséquent. La séquence de la prise de la Bastille, dans la première partie, reste à cet égard la plus spectaculaire du cinéma français par les moyens déployés - figuration, décors, effets pyrotechniques. Elle est à comparer avec celle d’Un peuple et son roi (Pierre Schoeller, 2018), plus elliptique et poétique.
Le plus décalé – Marie-Antoinette (2006)
Dans cette œuvre pop-rock de Sofia Coppola, la prise de la Bastille est vécue hors-champ par la Cour où les aristocrates redoublent de vice, de festivités et d’arrogance. Comme si ce 14 juillet décisif n’était qu’un caprice de ce peuple imbécile tant ignoré par la classe dirigeante. Dans le regard perdu de Marie-Antoinette, cette “étrangère” honnie que Kirsten Dunst incarne avec une sensibilité inouïe, passe tout le désarroi et l’inconscience d’une élite, incapable de comprendre que l’époque est en train de changer.
Le plus fin de règne – Les Adieux à la reine (2012)
En adaptant un somptueux roman historique de Chantal Thomas, Benoît Jacquot ne signe pas une reconstitution antiquaire, mais choisit plutôt de capter les derniers jours de Marie-Antoinette (Diane Kruger) entourée de ses servantes et courtisanes. Nous sommes à Versailles. Et au moment où le peuple prend la Bastille, la reine Marie-Antoinette se demande comment elle va s’habiller et si telle fanfreluche ira avec telle autre. En suivant les pas rapides et feutrés de Sidonie (Léa Seydoux), une jeune lectrice de la reine, on passe de couloirs obscurs en escaliers dérobés, de dortoirs surpeuplés en antichambres dorées, le parti pris étant celui de la claustrophobie. C’est à travers le regard de Sidonie qu’on observe la panique qui saisit les puissants au soir de leur déchéance et la débâcle mesquine et misérable de la cour est parfaitement traduite par une mise en scène cruelle et crépusculaire.
Le plus fou – La Fille du 14 juillet (2013)
Tourné dans la foulée de l’élection de François Hollande, au plus près des événements politiques de l’époque (il est notamment question du défilé du militaire auquel assiste le nouveau président), le premier film du trublion Antonin Peretjatko raconte la rencontre improbable, un 14 juillet, entre un gardien du Louvre, Hector, et la dénommée Truquette. Avec son ami Pator, il va tenter de séduire Truquette qu’il suit à travers la France. Ce résumé dit tout de cette comédie échevelée, imprévisible, qui doit autant aux comédies de Michel Lang qu’aux œuvres de Jean-Luc Godard ou de Jacques Rozier.