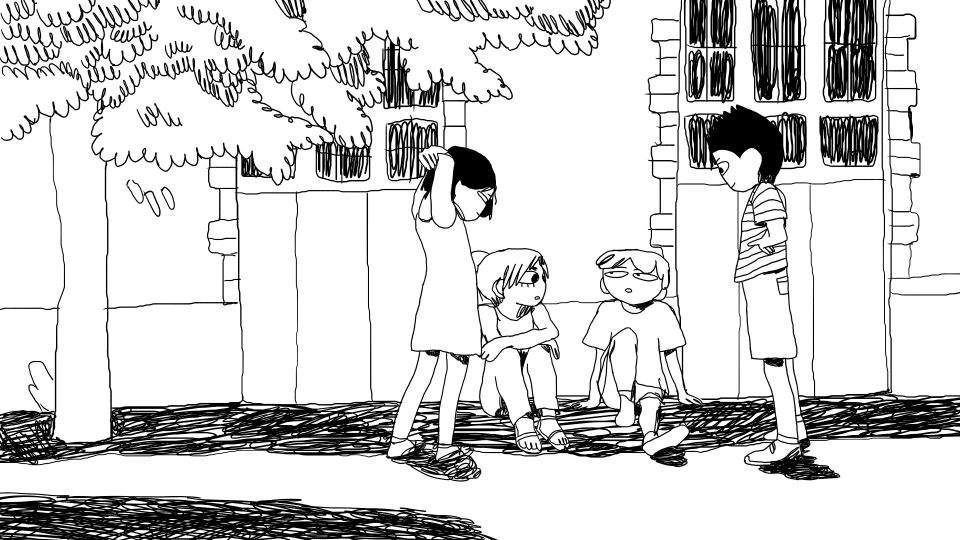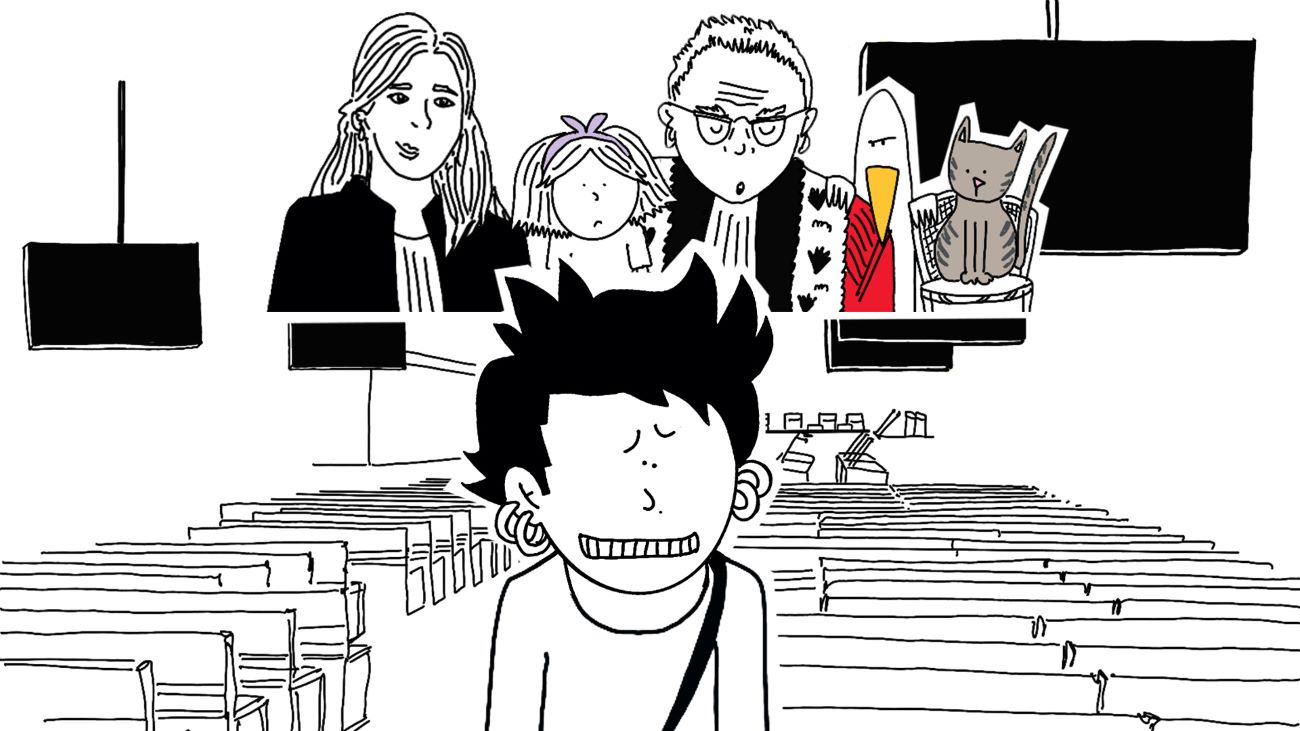Comment définiriez-vous votre duo ?
Sylvain Quément : Gangpol & Mit est l’association d’un graphiste et d’un musicien travaillant ensemble depuis 2001 sur un ensemble de projets, ayant pour point commun les rapports de l’image et du son. Nous avons commencé par nous faire connaître à travers nos live électroniques audiovisuels, dont l’esprit ludique, baroque et cartoonesque tranchait à l’époque avec l’esthétique minimaliste, et le collage façon VJing qui étaient encore prédominants. Depuis, le projet s’est étendu à tous types de formats : disques, livres, installations multimédias, mobilier sonore, concerts jeune public, workshops ou travaux de commande.
C’est votre première série et pourtant, vu votre univers visuel et sonore, ce format semblait être une évidence. Vous avez préféré attendre un peu avant de vous lancer ?
S.Q. : Partant du live audiovisuel, nous fonctionnions suivant des logiques et sur des réseaux différents, essentiellement liés à la musique, au spectacle vivant, aux arts numériques et à l’édition graphique. Ni groupe de musique ni studio d’animation, nous travaillions initialement en duo et en totale indépendance. Sans rien renier de ces débuts, à un moment, s’est fait sentir le besoin de pouvoir évoluer vers une forme plus produite, avec davantage de moyens, qui nous permette de soigner l’animation, s’autoriser des plans de foule, un découpage plus élaboré, une dimension plus épique... Le tout au service d’un propos plus structuré.
La série devient de plus en plus folle au fil des épisodes : j’ai ressenti en pagaille les influences de The Office, Brazil, Playtime, Black Mirror ou Message à caractère informatif. C’est un bon résumé ?
S.Q. : Plus ou moins, dans la mesure où, à titre personnel, je ne suis pas un grand consommateur de séries récentes, surtout faute de temps. Il y avait avant tout la volonté d’aborder des sujets et des problématiques actuelles – liées à la technologie et la société – sous un angle qui ne soit pas manichéen. Le nom de Black Mirror a commencé à circuler alors que la bible de Globozone était déjà rédigée, et j’ai pris le parti, discutable, de n’en visionner aucun épisode avant d’avoir terminé notre première saison. La série se nourrit parfois d’influences beaucoup plus classiques, sans qu’elles soient nécessairement discernables : que ce soit l’art de la parabole du Prisonnier de Patrick McGoohan, ou même le comique gestuel et muet de Rowan Atkinson, lui-même inspiré de Tati…
Guillaume Castagne : Moi, c’est l’inverse, j’ai saigné toutes les séries citées ! Et je suis friand de nouveautés. Mais c’est vrai que Le Prisonnier a été un choc commun qui nous a marqués.
Pour fabriquer la série, vous utilisez une technologie normalement pensée pour les jeux vidéo. Pourquoi ? Cela a compliqué ou, au contraire, facilité le processus de création ?
G.C. : Nous avons travaillé avec la société de production Umanimation qui a des compétences spécifiques et poussées avec le logiciel Unity. L’organisation de travail assez atypique que nous avons choisie (équipe restreinte, bande-son réalisée avant l’animatic, pas de dialogue, personnages « random » multipliables…) a bien fonctionné avec Unity, qui est en effet un moteur de jeu.
Quel est votre rapport au jeu vidéo ?
G.C. : On se renseigne, je vais souvent voir les sorties indépendantes. Visuellement, je suis attiré par les univers graphiques modernes et originaux mais mon temps de consommation d’écran est déjà trop volumineux pour réellement avoir le temps nécessaire pour les beaux jeux.
Le choix de ne pas faire parler les personnages était une évidence ?
S.Q. : Effectivement, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que tout ce que nous avons fait jusqu’à maintenant repose sur un humour visuel, l’écriture de dialogues n’étant pas notre spécialité. Ensuite, parce que la forme dialoguée – et au-delà, l’esthétique de « têtes qui parlent » – est devenue très envahissante, presque hégémonique. Nous voulions nous inscrire dans une tradition différente. Enfin, dans l’univers de la Zone, le fait que les personnages se retrouvent totalement dépossédés de la langue et de la parole était particulièrement significatif. Au final, c’est la Zone elle-même qui détient le monopole de la parole : plus personne ne s’y parle, la vie quotidienne n’étant plus rythmée que par une succession de messages automatiques ânonnés par une synthèse vocale inexpressive.
Comment naît un épisode ? D’abord par une idée un peu dingue, un projet scénaristique absurde que vous développez ensuite ?
S.Q. : Il y a bien sûr eu plusieurs cas de figure, mais une fois l’univers posé, nous nous sommes orientés vers une approche de plus en plus thématique. En imaginant des situations autour des thèmes du clonage, des implants sous-cutanés, de l’obsolescence programmée ou de la défaillance des détecteurs de mouvements dans les toilettes publiques…
G.C. : On avait aussi une sorte de boîte à idées (avec une galerie de personnages récurrents, des situations folles...) emmagasinées durant nos autres projets, au fil du temps passé ensemble.
Comment travaillez-vous ensemble ? Si l’un s’occupe principalement de la partie graphique et l’autre de la partie musicale, à quel point échangez-vous sur le travail de l’autre ?
S.Q. : C’est un ping-pong permanent. Dans mon souvenir, Guillaume a posé les bases de l’univers et des deux personnages. Nous les avons développées ensemble par la suite. La dimension futuriste s’est imposée en cours de route. L’écriture des scénarios est indissociable de l’univers visuel, dont elle découle directement (et non l’inverse).
G.C. : Un grand nombre de semaines de tournées, des hôtels ennuyeux, des attentes en backstage nous ont donné l’occasion de jouer à imaginer des situations étranges. Mais Abdu, l’agent de sécurité passionné d’expérimentations sonores bizarres, découle de rencontres improbables avec des tronches, de forts personnages que nous avons tous les deux appréciés dans la vraie vie.
Comment s’est passée la collaboration avec Arte et Umanimation ?
S.Q. : Idéalement. Aymeric Castaing, d’Umanimation, a cru à ce projet – qui n’avait rien d’évident – et s’est investi en nous laissant une totale liberté. Bien qu’il ait par ailleurs travaillé sur des projets parfois stylistiquement aux antipodes, il a su nous rassurer, et montrer qu’il comprenait parfaitement ce que nous essayions de mettre en place. L’intérêt et le soutien d’Arte tout au long du projet ont également été essentiels. Et je leur suis particulièrement reconnaissant d’avoir cru en ce projet de série d’animation musicale et sans paroles totalement à contre-courant, à une époque où la moindre vidéo doit être sous-titrée pour fonctionner sur les réseaux sociaux...
Est-ce qu’une nouvelle fournée d’épisodes est prévue sur Arte ? Avez-vous d’autres projets ?
S.Q. : Nous travaillons en permanence sur des projets très variés. Pour ma part, je suis également très investi dans le développement de Radio Minus, consacrée aux trésors cachés du disque pour enfants. Initialement webradio, qui se produit régulièrement en DJ sets, ses activités se sont élargies avec une exposition sur le même thème. Je termine présentement la rédaction d’un ouvrage sur le sujet, à paraître en 2022 aux éditions L’Articho. Tout en travaillant sur diverses musiques de spectacle, des ateliers de fabrication d’automates musicaux, et en poursuivant avec grand plaisir la collaboration au long cours avec Guillaume.
G.C. : Après cette série, j’ai rapidement enchaîné sur de nombreux projets liés à l’art dans la ville. C’est sûrement lié à une envie de chantiers physiques, qui ne soient pas seulement numériques, et d’explorer des interventions concrètes avec l’architecture et nous tous habitants. Le travail de série d’animation reviendra sûrement prochainement.
Globozone est disponible sur le site d’Arte.