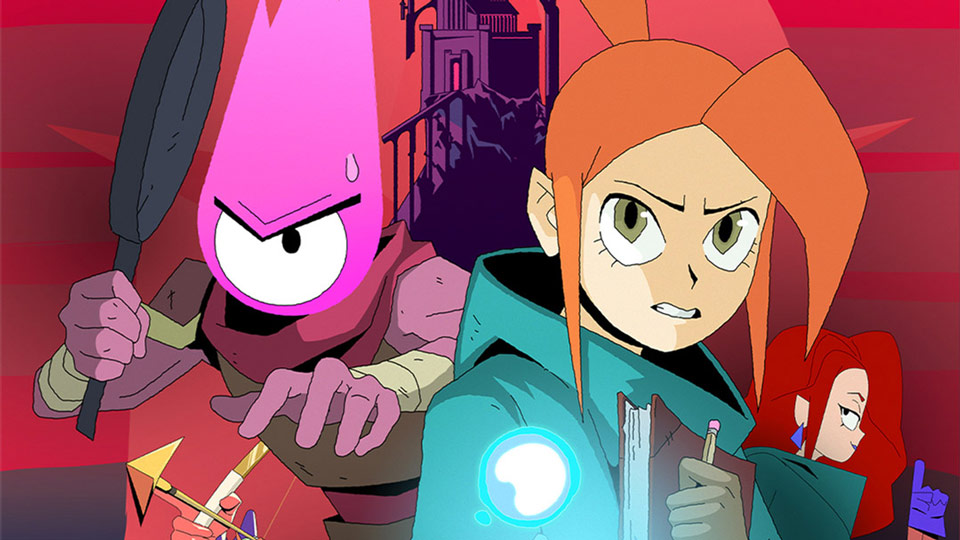Pourquoi avez-vous eu envie d’adapter le roman de Pierre Lemaitre ?
Ça ne s’est pas passé comme ça. C’est même l’inverse qui s’est produit : c’est Pierre Lemaitre qui m’a contacté par mail pour me proposer d’adapter son livre. La démarche était originale, son approche intrigante et ses arguments m’ont tout de suite touché.
Quels étaient ces arguments ?
D’abord, il disait aimer mes films (rires). Plus sérieusement, il savait que je ne travaille habituellement que sur des scénarios que j’ai écrits. Dans ce cas, il voulait vraiment que je m’empare de son récit, que je le fasse mien et que je transpose son univers en image, en langage cinéma. C’était la promesse d’un travail passionnant et je sentais que je pourrais y injecter ce qui m’intéresse toujours dans les histoires - l’ambivalence, l’ambiguïté… Enfin, je crois que j’avais envie de travailler sur une commande.
Vous avez tout de suite dit oui ?
Non : je dois avouer que j’ai d’abord été dubitatif. Je travaillais sur un autre projet à l’époque, mais Lemaitre m’a envoyé son script et j’ai tout de suite été captivé.
Trois jours et une vie est un vrai film populaire. Pourtant, il n’y a pas de stars au générique. Ou plutôt si : Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Philippe Torreton sont bien au casting, il s’agit de seconds rôles. Comment avez-vous géré cela ?
Très facilement, parce que la tête d’affiche ici c’est justement Pierre Lemaitre. Entre le moment où il m’a contacté pour adapter son livre et la fin du tournage, Au Revoir là-haut de Dupontel était sorti et Lemaitre était devenu encore plus connu du grand public. Dès le début, tout le monde savait que cette histoire chorale, située à deux époques différentes, ne pourrait pas s’appuyer sur des « têtes d’affiches » donc on était libres. Pour le casting, j’ai tout de suite dit à Lemaitre que comme il s’agissait de son univers, je ne prendrais pas d’acteurs qui ne lui conviendraient pas. Inversement, s’il choisissait des acteurs qui ne m’allaient pas, je pouvais y opposer mon véto. Il tenait à me présenter Philippe Torreton qu’il voyait bien dans le rôle de l’ouvrier (finalement joué par Berling), ce qui ne me paraissait pas très intéressant. Par contre, en médecin de province, rongé par un secret, c’était différent et ça devenait excitant… C’est comme ça qu’on a travaillé ensemble.
Comment définiriez-vous son univers de romancier ?
C’est du ressenti et des personnages très humains, très réels, toujours porteurs d’émotions, avec un fond bien français. Ce qui m’a plu immédiatement c’est ça : cette galerie de portraits caractéristiques qui permet d’observer la petite humanité et permet au passage de retrouver la valeur des « seconds rôles » dont vous parliez... C’est un univers où la notion de classes sociales a encore du sens, où le mot communauté résonne. L’idée du crime comme axe central du récit amène chaque membre de cette communauté à se redéfinir... C’est formidable comme structure. Certains de nos plus grands classiques répondent à ça.
C’est amusant que vous mentionniez cela : on est sorti du film en se disant que c’était sans doute celui où vous vous revendiquiez le plus de Duvivier.
Je ne pouvais pas refuser un script qui, effectivement, mettait les doigts dans la prise de ce cinéma-là : Duvivier, Decoin, Clouzot... Des films de village ! C’était ça qui me fascinait : un film de village, un fait divers qui permet d’explorer la réalité tout en étant totalement romanesque.
Comment avez-vous procédé pour le travail d’adaptation ?
J’ai d’abord voulu modifier les choses, mais ça ne fonctionnait pas. J’ai donc choisi de suivre fidèlement l’histoire et de la filmer de la manière la plus simple possible. Je n’ai pas rajouté d’artifices et je me suis rendu compte très vite que le film avait sa force propre. C’était bizarre : on a été obligé d’enlever les séquences les mieux mises en scène. Les moments où les acteurs étaient les meilleurs ont disparus. Les plus beaux plans du chef op’ ont été abandonnés… On a tout enlevé parce que ça ne « rentrait » pas. Lemaitre était le plus fort ! Un peu comme Stephen King. A part Kubrick, si tu te crois plus fort que King, tu échoues. Les gens qui l’ont le mieux adapté sont ceux qui l’ont adapté littéralement.
Jusque-là, votre cinéma était frappé par une certaine modestie. Comme si vous aviez peur d’être trop ambitieux, vous dégraissiez tout. Dans ce film en revanche il y a presque une dimension métaphysique. Est-ce que c’est lié au fait que vous n’avez pas écrit le script ?
Si je « dégraissais », comme vous dites, c’était d’abord pour des raisons de budget. Ça n’a jamais été un système. Je crois vraiment en l’idée du prototype. Chaque film possède sa vérité industrielle. C’est de l’artisanat et ça permet d’être plus réactif, plus flexible et surtout d’être branché sur l’époque. Moi je lis Le Parisien tous les jours. Et ça vibre dans les pages du Parisien ; tu as les doigts dans la prise du réel. Si tu es artiste, la question se pose différemment, tu te demandes sur quel sujet tu vas te pencher cette fois, tu réfléchis sur ton œuvre…
Vous refusez l’idée de signature ?
Il faut être identifié pour ça. Comme Federico Fellini qui était le seul cinéaste dont le nom figurait jusque dans les titres de ses films : « Fellini Roma » « Le Casanova de Fellini ». Moi, je ne suis pas identifié par les gens. D’ailleurs si je prends des repères français c’est quoi les carrières qui m’intéressent ? Des gens comme Corneau, Chabrol, Boisset. Pas vraiment des cinéastes obsédés par leur signature.
Mais c’était une autre époque. Lorsque l’on tournait un film par an. Aujourd’hui on ne peut plus faire une carrière à la Chabrol.
Parfois il y a des moments où tout s’enchaine bien… En 5 ans j’ai fait trois ou quatre films. Il suffit qu’on me propose un scénario et c’est bon. Avec Lemaitre c’est bien tombé par exemple. L’air de rien, lui non plus ne réfléchit pas. Il a une idée et il part… Il raisonne en intuition, pas en thématique. C’est très pragmatique au fond comme approche et je crois que ça me correspond bien.
Trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief sort le 18 septembre 2019.