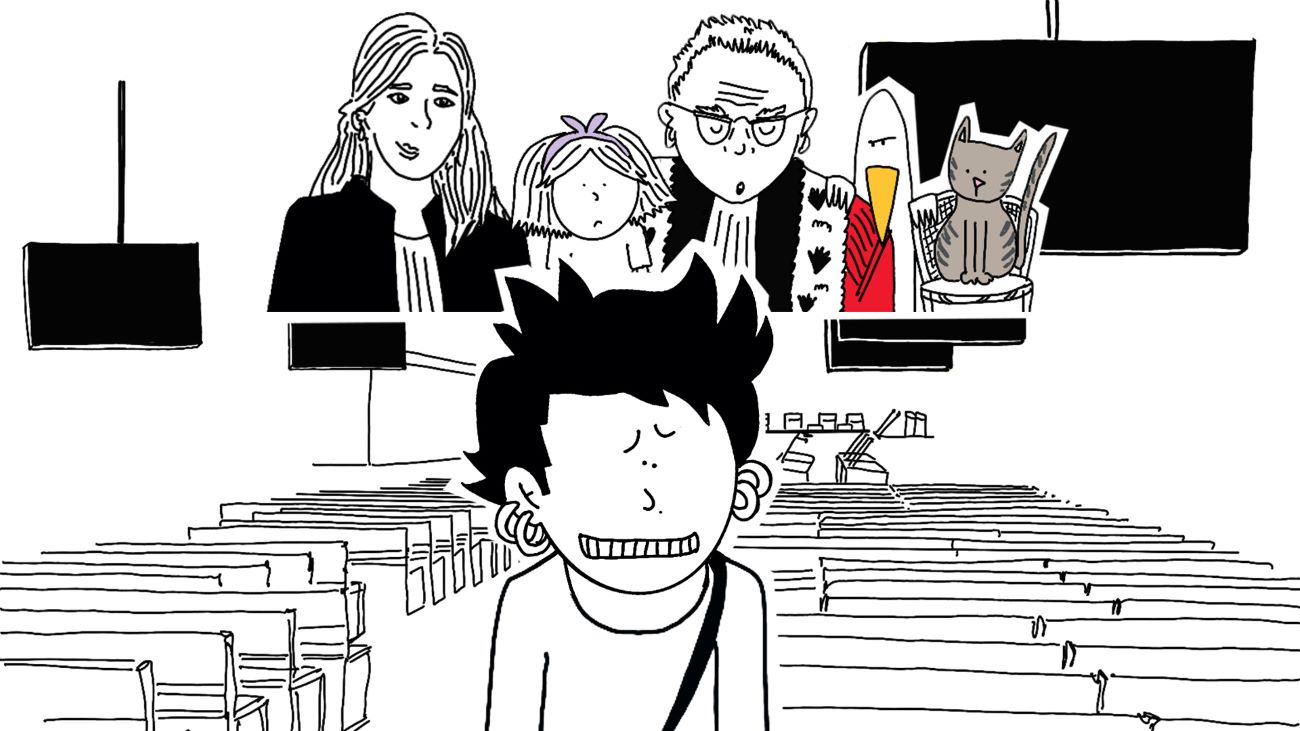Quel était le contexte de cette expédition ?
Avec Laurent Ballesta, nous sommes habitués aux plongées profondes qui ont un gros inconvénient : elles nécessitent de gros paliers de décompression. Lors d’une plongée de 30 minutes, il faut ainsi remonter en 4 heures, ce qui est pénible. Nous cherchions donc depuis longtemps à explorer les profondeurs sous-marines au-delà des 50m et d’approcher des 150m de profondeur. Nous avons commencé en Afrique du Sud pour chercher le coelacanthe (un poisson préhistorique dont l’espèce existe depuis 400 millions d’années, ndlr) à 120m de profondeur. Mais les plongées ne duraient que 20 minutes. Il y avait une vraie limite en termes d’exploration naturaliste, un peu comme si un botaniste pouvait étudier les oiseaux dans la forêt uniquement pendant 20 minutes de sa journée. Il fallait trouver une méthode permettant de rester plus longtemps sous l’eau, et ça s’appelle la saturation. Pourquoi le faire dans la Méditerranée ? C’est une plongée très technique et il existe peu de moyens disponibles ailleurs qu’en France ou aux Etats-Unis, il n’est donc pas possible de faire de la saturation partout sur la planète. De plus, avant de tenter cette technique autour du monde, nous voulions rendre hommage à la Méditerranée qui a tant de secrets encore à nous dévoiler. Laurent, qui a une société d’expertise en écologie marine, y plonge depuis 30 ans. Il la connaît donc bien mais connaissait vaguement les endroits que nous avons explorés car il n’avait pu y rester longtemps.
Quels dispositifs ont été mis en place pour filmer ce documentaire ?
J’étais présent sur le bateau pour filmer. Ce qui est dommage, c’est que nous n’avions qu’une seule caméra à plus de 100 mètres de profondeur, celle de Yanick Gentil qui faisait partie des 3 aquanautes enfermés avec Laurent. Pour filmer les coulisses, j’avais une dizaine de caméras télécommandées à distance capturant aussi bien l’image que le son car je ne pouvais pas accéder au caisson qui était sous pression. J’avais de mon côté une caméra terrestre à l’épaule et, avec le cameraman Yann Rineau, nous filmions les autres scientifiques et les avatars, noms donnés à ceux qui préparent le matériel de plongée. Je souhaitais rendre hommage à ces derniers car les 4 aquanautes ne méritent d’être là qu’à travers aussi le travail des autres.
Le terme aquanaute a une vraie dimension poétique…
L’amalgame pourrait être fait. La conquête spatiale demande beaucoup d’argent pour aller voir s’il y a une bactérie sur Mars. Nous, nous découvrons à chaque plongée bien plus qu’une bactérie. Avant d’aller chercher des choses hypothèques sur cette planète, il faudrait donner assez de moyens pour explorer notre planète en profondeur.

Quels étaient justement les moyens mis en œuvre pour produire et réaliser ce documentaire ?
La production, c’est-à-dire l’argent, est le nerf de la guerre. Arte apporte sa contribution. Mais monter une telle expédition demande des fonds encore plus importants, nous sommes donc obligés de chercher d’autres partenaires tels que Blancpain, qui nous suit depuis 10 ans, et la Principauté de Monaco qui est très investie dans la recherche océanographique.
Comment capturer en images une telle expédition ?
Nous avons tourné pendant 28 jours sur la barge mais préparer le tournage m’a demandé plus d’un an de travail. La préparation technique s’est déroulée entre septembre 2018 et juillet 2019. Mettre les caméras à l’intérieur du caisson n’a pas été simple car elles étaient soumises à la pression : elles n’implosaient pas mais toutes présentaient des défaillances ou se mettaient en off à partir de 5 ou 6 bars de pression alors que nous montions à 11 bars dans le caisson. J’ai dû en essayer un grand nombre avant de trouver des caméras Marshall, une marque américaine. J’ai fait de nombreux allers-retours au centre hyperbare de la Comex, qui dispose de caissons permettant de mettre en pression des instruments, afin de tester leur résistance. Si mettre des caméras dans le caisson était impossible, je n’aurais pas fait le film. Il n’était pas question pour moi de faire le premier film en saturation sans voir comment vivaient vraiment les 4 aquanautes ainsi qu’en me contentant d’images sous-marines et de plans filmés à travers le hublot. Le public avait besoin de s’identifier, de les voir vivre. Nous disposions de 7 caméscopes pour les 15 caméras du caisson. Deux personnes de l’équipe se relayaient jour et nuit devant le pupitre pour regarder ce qu’il se passait à l’intérieur et changer de caméra en appuyant sur des boutons, un peu comme un réalisateur de match de foot qui doit suivre où se passe l’action.
Qu’en est-il pour le travail du son ?
L’hélium qu’ils inspiraient jour après jour agissait sur leurs cordes vocales et leur donnait une voix de canard inaudible. Ils avaient d’ailleurs beaucoup de mal à avoir des conversations sérieuses et restaient assez muets. J’avais un ingénieur du son œuvrant exclusivement pour trouver le moyen de faire un travail instantané sur le son, un peu comme un démodulateur, afin de transformer en quelques secondes leur voix de canard en voix normale. Ce qui nous permettait de mieux les entendre et eux, grâce à un casque et un micro, de mieux se comprendre.

Comment condenser une telle aventure en un documentaire de 1h35 ?
Monter un tel film, c’est beaucoup de frustration. J’ai mis de nombreuses séquences à la trappe en travaillant avec mon monteur, Frank Leplat, qui avait un œil extérieur. Il me disait : « Là on s’enferme trop, là on est dans un tunnel, là c’est une blague entre vous que le public ne comprendra pas… » La discussion était permanente en regardant les rushes. Nous avions 300 heures d’images pour un film d’1h36. J’ai passé 3 mois à tout regarder et écouter avant de monter. Si l’image est belle, les anecdotes et interjections entre eux sont aussi intéressantes. Mais elles ne sont pas faciles à déceler au milieu de tout ce qu’on avait. En utilisant des cahiers, des marqueurs, des bases de données, nous avons réussi à sélectionner une centaine d’événements et à faire un dérushage d’une dizaine d’heures. Puis nous avons réduit au fur et à mesure. Il y a eu de vraies déchirures.
Comment s’est déroulée la collaboration avec Laurent Ballesta ?
Il a amené l’idée originale et m’a demandé si je voulais réaliser. Il a ensuite écrit le dossier. Il est là en permanence pour l’écriture et je réalise. Il me fait confiance et c’est bien car il a tellement de choses à faire de son côté. Il doit me laisser faire mon film comme je l’entends même s’il intervient beaucoup au niveau de l’écriture et notamment du commentaire voix-off. Pour le faire, nous nous sommes enfermés tous les deux pendant 10 jours environ et nous avons réfléchi à chaque mot, chaque intonation, chaque propos pour que ce soit agréable et « digérable ».
Des photos de Laurent Ballesta s’entremêlent aux images tournées par la caméra sous-marine. Comment s’est fait le dialogue entre ces deux sources d’images ?
Assez naturellement. Laurent étant photographe sous-marin, il était facile de justifier l’insertion de photos. Mais il faut reconnaître qu’il a des appareils que nous n’avons pas. Nous tournons à 25 images/seconde et Laurent fait une photo avec des capteurs dont nous ne disposons pas au cinéma et une dynamique plus importante. Il peut travailler le contraste, il a 21 millions de pixels et nous 12 ou 15 millions… Ses photos sont plus belles que ce qu’il est possible de faire en vidéo. Il est capable de saisir des choses que Yanick, qui avait un caisson de 70 kilos plus difficile à manier, ne pouvait pas avoir. Ses photos apportent une vraie valeur ajoutée.
Soutenu par le CNC, Planète Méditerranée est à voir samedi soir à 20h50 sur Arte et jusqu’au 17 novembre sur Arte.tv. Le film est coproduit par ARTE France, Les Gens Bien Productions, Andromède Océanologie, avec le soutien de Blancpain. Une série en plusieurs épisodes a également été consacrée à cette expédition mise aussi à l’honneur dans un livre-photos qui paraitra le 22 octobre prochain aux éditions Exhibitions International.