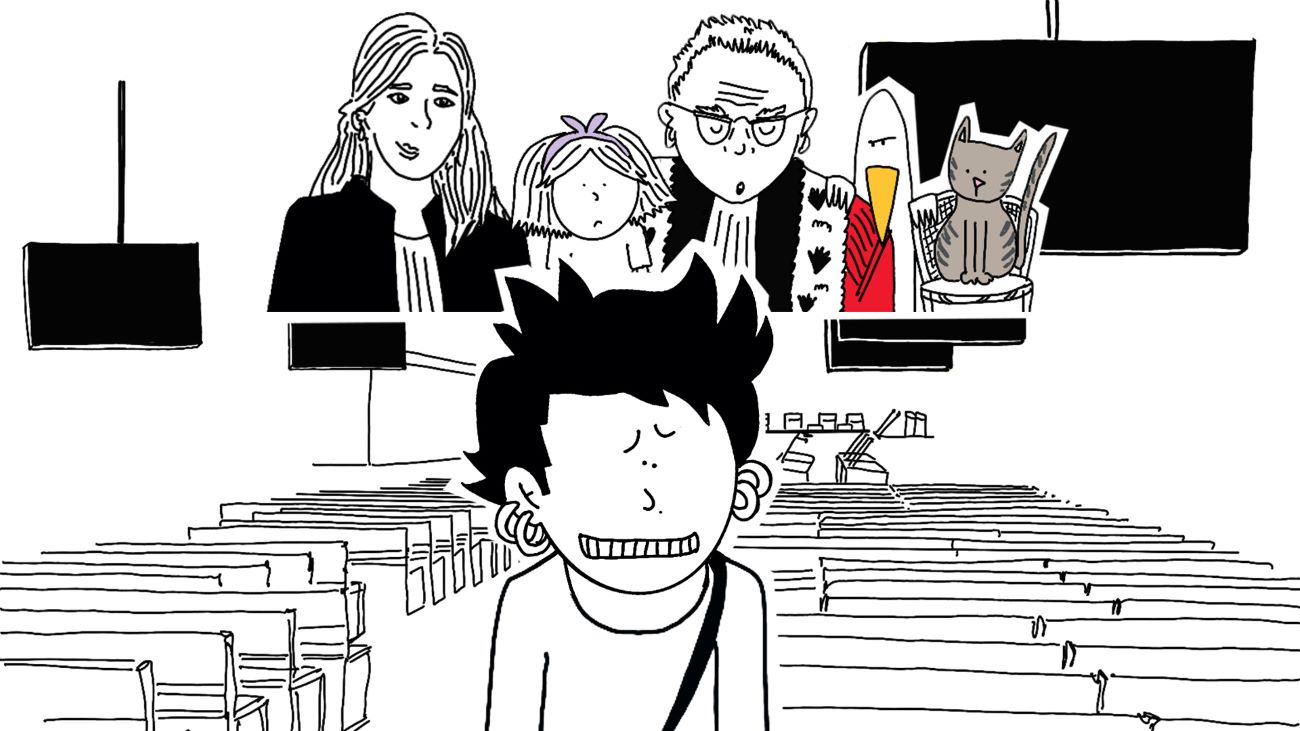Quelle est la genèse de ce documentaire ?
Durant mon master de géographie sociale en 2012, je me suis intéressée aux questions de ségrégation socio-spatiale. J’ai travaillé sur plusieurs terrains, notamment dans un camp palestinien en Jordanie. J’y ai tourné un premier documentaire, dans le cadre de mon mémoire. Et dans la foulée, alors que je finissais mes études à New Delhi, j’ai eu envie de me pencher sur le cas de l’Inde. J’avais remarqué, en habitant sur place, que les étudiants de mon campus étaient très inquiets de la montée du nationalisme hindou et du discours islamophobe. Et cela résonnait fortement en moi. Je me suis aperçue qu’en Inde, l’une des plus grandes démocraties du monde, on retrouvait les mêmes problématiques identitaires que dans nos démocraties occidentales. C’est pour cela que j’ai voulu creuser le sujet.
Comment avez-vous fait la connaissance des sœurs Pathan ?
Je les ai rencontrées pour la première fois en 2016. J’ai commencé à explorer le quartier de Juhapura dès 2012, pour mon master 2. Et puis en 2014, quand Narendra Modi [le Premier ministre de l’Inde, NDLR] et les nationalistes hindous sont arrivés au pouvoir, j’ai eu envie de faire du documentaire. Pour mon premier film, j’ai choisi de reprendre mes recherches du côté de Juhapura. Au fur et à mesure, les années passant, je me suis rendu compte que le sujet était de plus en plus pertinent. Ainsi en 2016, j’ai fait des entretiens dans une école du ghetto musulman, à la recherche d’histoires à raconter. Et j’ai rencontré Sofia, qui avait alors 15 ans. Elle a planté son regard sur moi d’une manière intrigante. Elle m’a fait rencontrer son père, qui m’a raconté leur histoire. Il était ouvert à l’idée d’être filmé, d’intégrer une caméra dans le quotidien de la famille. Son fils avait déjà participé à un documentaire et ça a aidé. Il savait la puissance qu’un documentaire peut avoir. Et surtout, il voulait raconter son histoire en dehors de l’Inde.
Pendant combien de temps avez-vous suivi cette famille ?
Le projet a commencé en 2016 et il s’est achevé en 2022. On a filmé au cours de ces six années, même s’il y a eu le Covid entre-temps. J’ai pu me rendre là-bas à différentes reprises. Ceci dit, on les voit quand même grandir, passer d’adolescentes à jeunes femmes. Au total, je crois qu’on a dû filmer 180 heures avec elles.
Que cherche à raconter le film ?
L’idée centrale, c’était de parler de la situation politique actuelle en Inde. Parce que c’est un peu le cauchemar de Gandhi qui est en train de se réaliser. Les nationalistes hindous au pouvoir polarisent la société indienne, avec un agenda qui tend à mettre au ban les minorités, qu’elles soient musulmanes ou chrétiennes. Je voulais travailler cette question, qui traverse d’une certaine manière également nos sociétés occidentales, avec la montée progressive de l’extrême droite. Et je voulais surtout en parler de manière intime. C’est pour ça qu’il fallait que je sois autonome, sans interprète, pour communiquer naturellement avec les filles et accéder à des points de vue très intimes.
Comment avez-vous géré la barrière de la langue ?
J’ai appris l’hindi afin de pouvoir créer une connexion et un lien fort. Pour moi, c’était obligatoire pour réaliser un bon film. C’était difficile, parce que je n’habitais pas sur place. Je travaillais à Paris. J’ai suivi des cours le matin, des stages de langues… Mais je ne partais pas de rien. J’avais un petit bagage qui remontait à mes études universitaires à Delhi. Et puis les filles m’ont beaucoup aidée. Elles ont été très patientes ! (Rires.) Sofia parlait un peu anglais de son côté, on a pu aussi mélanger les langues pour se comprendre.
Et la barrière culturelle ? Est-ce que les filles se sont confiées facilement ?
Le fait que je sois étrangère me mettait en dehors du système social indien, donc ça a simplifié les choses. Et le fait que je sois une femme aussi. La parole a été plus libre.

Se pose-t-on la question de la sécurité quand on filme dans un quartier comme Juhapura ?
Non, parce que c’est un ghetto au sens sociologique. Après, c’est vrai que lorsqu’on monte dans un rickshaw (taxi-vélo) et qu’on dit qu’on va à Juhapura, le chauffeur vous regarde bizarrement et se demande ce qu’une étrangère va faire là-bas. Les gens d’Ahmedabad pensent que c’est un quartier mal famé. Mais ce n’est évidemment pas la réalité. On a juste forcé les musulmans à vivre dans ce quartier, qui est moins développé que le reste de la ville. Il n’est pas dangereux en soi.
Êtes-vous encore en contact avec les sœurs Pathan ?
Bien sûr. Nous sommes très proches et maintenant qu’elles ont des téléphones portables, on peut échanger très facilement avec WhatsApp. L’aînée s’est mariée avec l’homme avec qui elle entretenait une relation clandestine, et qu’on entend dans le documentaire. J’aimerais retourner sur place pour montrer mon film à leur père. Je voudrais être là, avec lui, quand il le regardera. Les filles, elles, l’ont vu sans moi. Elles ont beaucoup aimé. Ce visionnage leur a rappelé de bons souvenirs, car ce sont finalement des fragments juxtaposés de moments passés ensemble.
Vous avez notamment bénéficié du Fonds d’aide à l’innovation documentaire (FAI doc) du CNC. Qu’est-ce que ce soutien a-t-il changé pour vous ?
Les aides en développement sont rares. C’est un soutien très compétitif. Et quand il y en a une, ça change beaucoup de choses. J’ai obtenu cette aide en 2018. Et cela m’a permis d’aller faire mon premier repérage filmé sur place. J’ai pu me rendre à Juhapura pour la première fois avec du matériel professionnel et y tourner mes premières images. Ça a vraiment été un déclencheur.
les soeurs pathan
Image : Cédric Dupire, Eléonore Boissinot, Aniket Deore
Montage : Perrine Bekaert, Laureline Delom, Cédric Dupire
Musique originale : Bertrand Wolff
Mixage : Thomas Besson
Production : Claire Babany et Dryades Films, avec la participation de France Télévisions
Le 1er novembre à minuit, sur France 2, dans la case "25 nuances de docs", et en replay sur la plateforme FranceTV.