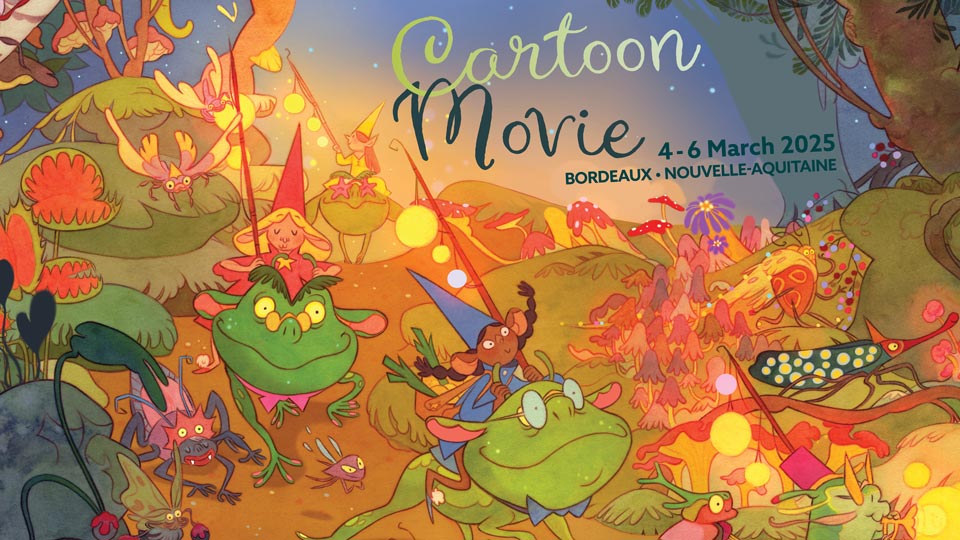Grand Prix de la Semaine de la critique à Cannes, Cristal du long métrage et Prix du Public à Annecy, J’ai perdu mon corps bouleverse le public depuis qu’il a été dévoilé sur la Croisette en mai dernier. Cette histoire d’une main séparée de son corps, qui déambule dans la ville pleine de dangers tandis qu’en parallèle un jeune homme vit une histoire d’amour compliquée, fait partie de ces œuvres singulières qui ne s’oublient pas.
À quand remonte votre envie d’adapter Happy Hand, le roman de Guillaume Laurant ?
J’ai rencontré Guillaume fin 2010 pour un autre projet. Nous avons sympathisé et il m’a fait lire son roman qui m’a fortement impressionné. Comme il connaissait mon intérêt pour l’imaginaire, il a sans doute pensé que je pourrais initier son adaptation. J’aimais beaucoup l’idée de l’inversion du rapport de manque entre la main et son corps. Cette main incarne la mémoire du héros, c’est une belle métaphore. Il y avait un défi formidable qui consistait à pousser le spectateur à avoir de l’empathie pour un “personnage” à cinq doigts. Je savais cependant que l’adaptation serait complexe et ambitieuse.
Article sur le même sujet
Combien de cinéastes avez-vous envisagé avant de jeter votre dévolu sur Jérémy Clapin ?
J’en ai considéré plein dans ma tête mais Jérémy est le premier que j’ai vu. J’ai toujours cru que quelqu’un venant du court métrage serait plus à l’aise pour traiter ce genre de sujet. Pourquoi ? Parce qu’en animation, il n’y a que dans les courts qu’on se frotte à la mise en scène du quotidien, des sentiments, des choses triviales de la vie en somme. Quand j’ai découvert le court multiprimé de Jérémy, Skhizein, j’ai constaté qu’il avait une façon unique de faire sourdre simplement le surnaturel dans le réel. Il est très proche en cela d’un écrivain comme Haruki Murakami que je lis beaucoup.
A-t-il été facile à convaincre ?
Assez, oui ! (rires) Je sortais à l’époque de Gainsbourg, vie héroïque qui avait été remarqué. Jérémy avait compris que je pouvais avoir des ambitions visuelles et narratives un peu singulières. Il voyait aussi comment s’emparer du roman de Guillaume Laurant.
À l’arrivée, le film est très différent du roman. À quel point Guillaume Laurant, crédité à l’adaptation, a-t-il été concerné par ces aménagements ?
Nous étions tous conscients, Guillaume y compris, que le roman avait une force et une faiblesse pour une adaptation au cinéma : sa force tenait dans le récit de la main ; sa faiblesse, dans la trajectoire de Naoufel, qui subissait trop les événements. Guillaume a beaucoup travaillé avec Jérémy au début du processus d’écriture pour caractériser davantage Naoufel et explorer de nouvelles pistes narratives. Puis, il a fallu à un moment donné que Jérémy s’empare du sujet à bras-le-corps.
Le film a été tourné en images de synthèse puis retouché pour avoir un rendu 2D réaliste. Est-ce une première et était-ce techniquement compliqué ?
La réponse est oui aux deux questions ! (rires) Nous avions plusieurs difficultés à résoudre. À partir du moment où nous racontions une histoire d’amour, nous devions mettre en place un dispositif technique qui nous permette d’aller chercher une subtilité qu’on ne trouve normalement que dans la prise de vues réelle -l’animation va plutôt naturellement vers la schématisation et la simplification. Pour rendre une gestuelle et un comportement des personnages réalistes tout en faisant cohabiter graphiquement le surnaturel et le réel, nous étions obligés de recourir à la 3D. Une fois que cette 3D a été faite, il fallait trouver un moyen d’obtenir un rendu 2D hyper fin, le seul à même de retranscrire l’émotion réaliste, picturale et poétique que l’on recherchait. Jérémy, qui est un bidouilleur exceptionnel, a eu une idée de génie en développant le script d’un logiciel qui sert normalement à autre chose !

Un film d’animation pour adultes, avec un réalisateur inconnu du grand public et des défis techniques à relever, c’est une drôle d’aventure. Comment arrive-t-on à monter un projet pareil aujourd’hui ?
Sur le papier, c’est impossible. On a financé le développement nous-mêmes puis on a passé deux-trois ans à chercher de l’argent sans en trouver. Nous avons eu seulement l’aide des régions, du CNC, du crédit d’impôt et de quelques Soficas qui a permis de financer la moitié du film. L’autre moitié a été couverte par Xilam, ma société. Ça en dit long sur le chemin que doit encore parcourir l’animation pour adultes pour convaincre les décideurs de son potentiel. Obtenir un tel résultat avec un budget de 5 millions d’euros, autofinancé en grande partie, relève du miracle qu’on ne peut pas reproduire à l’infini.
La sélection cannoise a déclenché un intérêt grandissant pour le film. Était-ce vital pour un projet de cette nature d’être à Cannes ?
Totalement. Un mois avant Cannes, personne ne nous attendait en dehors du petit cercle de l’animation. Là, en quelques jours, ça a été un véritable tsunami ! La vitrine cannoise est un accélérateur de particules stupéfiant.
Vous êtes actuellement aux États-Unis pour la campagne pré-Oscars. Comment cela se passe-t-il ?
Il faut savoir que ces campagnes sont extrêmement coûteuses et complexes à mener. Cela consiste en beaucoup de projections et de festivals, bref à faire en sorte qu’un maximum de votants voient le film dans les meilleures conditions possibles, à savoir en salles. Il faut compenser notre déficit de notoriété par rapport à des grosses machines comme Toy Story 4. Participer à cette campagne pré-Oscars et éventuellement être sélectionné est vital pour le futur : nous aurons probablement moins de difficultés à financer un nouveau projet de ce type.
A combien estimez-vous vos chances d’être sélectionné ?
On le saura le 13 janvier… Le vrai pari pour nous n’est pas tant d’être nommé dans la catégorie Animation que de pousser le film dans d’autres catégories. Cela aiderait à le considérer comme un film tout court avec un grand scénario, une grande musique, un travail de montage et de réalisation pointu.
J’ai perdu mon corps, en salles le 6 novembre, a bénéficié de l’avance sur recettes après réalisation, l’aide au développement de projets de long métrage, l’aide à la création de musique de film, l’aide sélective à la distribution (aide au programme) et l’aide à la création visuelle ou sonore.